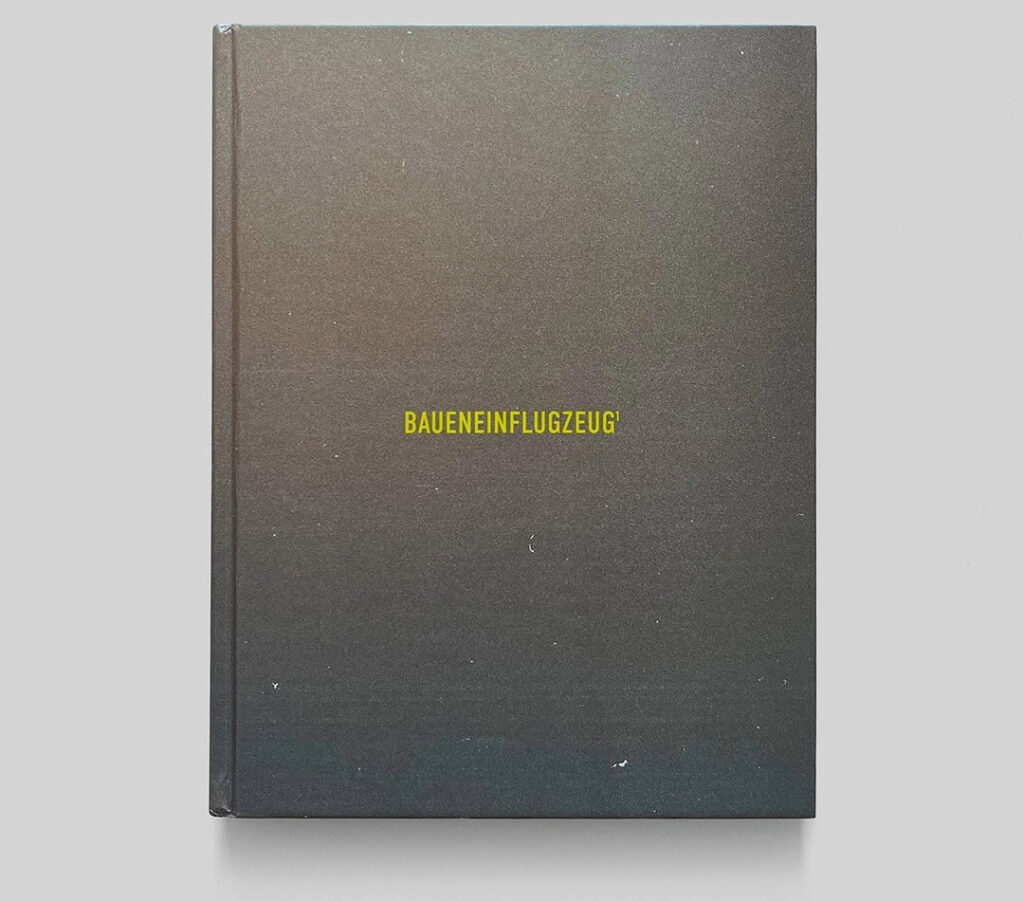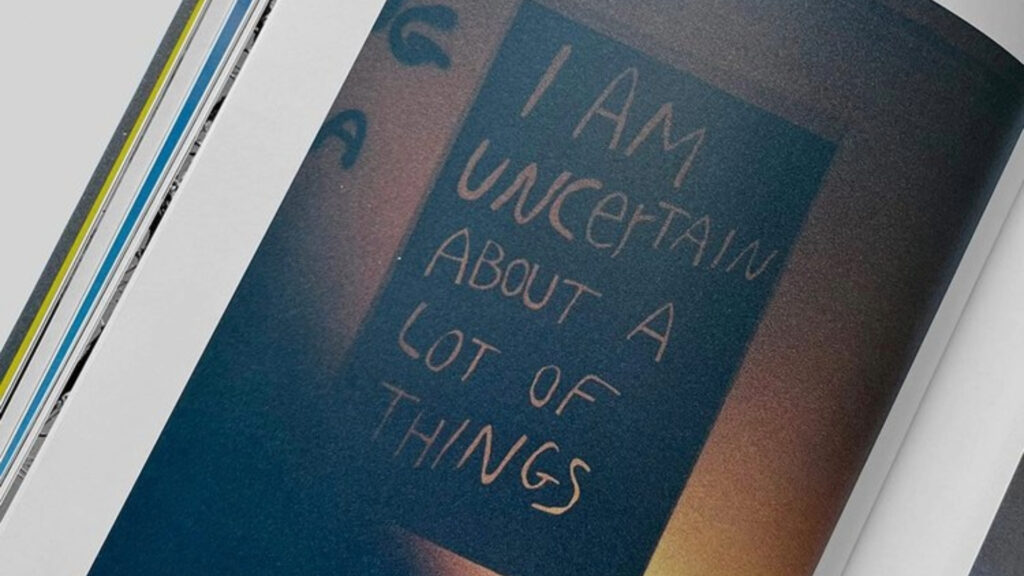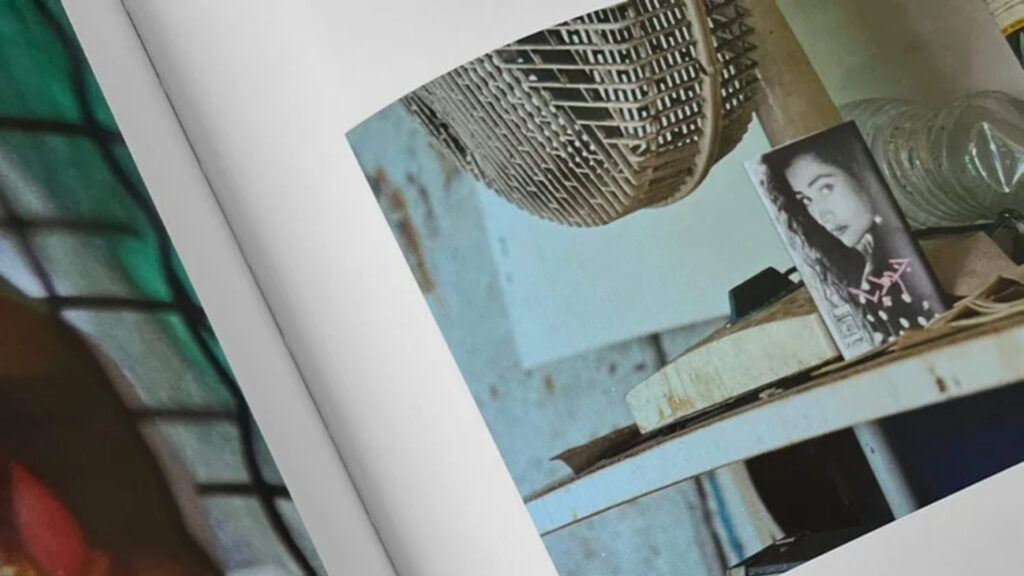Figure emblématique de Saint-Germain-des-Prés, mascotte du Quartier latin, il a même son portrait en fresque à l’angle de la rue du Four et des Canettes. Après plus de cinquante ans passés à vendre des journaux dans la rue, Ali Akbar — dernier représentant d’une profession en voie de disparition — a reçu la médaille de chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Chaque jour, il parcourt encore plus de quinze kilomètres à pied, un paquet de journaux sous le bras, pour en vendre à peine une quarantaine d’exemplaires. Une réalité qui n’étonne plus vraiment : dans les transports, les regards sont rivés aux écrans, et ceux qui font le choix délibéré de la matérialité du papier deviennent rares, presque précieux.

Dernier vendeur de journaux à la criée, Ali Akbar arpente inlassablement les rues parisiennes, notamment à Saint-Germain-des-Prés. Le Monde, Le Figaro, Libération parfois Charlie Hebdo : il les porte comme on porte une mémoire vivante. Malgré sa notoriété, malgré les interviews, malgré l’âge et même malgré la retraite, Ali bat encore le pavé, brandissant ses journaux comme d’autres lèvent un drapeau.
Il connaît ses clients par cœur. Se souvient des prénoms, des habitudes, des préférences — Le Monde pour l’un, Le Figaro pour l’autre, Libération pour les plus fidèles. Peu importe la météo. Qu’il pleuve, qu’il neige ou que le froid saisisse les doigts, Ali pousse la porte du Café de Flore, des Deux Magots ou d’un restaurant du quartier, et apporte avec lui une gaieté immédiate, presque contagieuse.
« Ça y est ! Trump va racheter la Corse ! »
Car Ali ne vend pas seulement des journaux. Il annonce l’actualité à la criée, à sa manière. Il l’improvise, la détourne, la poétise parfois. Toujours avec la même anaphore, devenue signature : « Ça y est… ». Une accroche qui amuse la galerie, déclenche des sourires, interrompt une conversation. Entre deux bons mots échangés avec les habitués, les touristes venus chercher leur exemplaire ou les serveurs qui le saluent, les titres prennent une autre saveur : « Ça y est ! François Fillon a rendu l’argent ! », « Ça y est, Marine le Pen s’est convertie », « Ça y est ! Sarah Knafo est avec François Hollande ! ».
Et pendant quelques secondes, au détour d’un café parisien, l’actualité redevient une voix, un corps, une présence.
Un monde où le journal est un lien, un prétexte, un sujet de conversation. Un moment de curiosité partagé, quand on jette un œil à la Une que tient nonchalamment le voisin. Un support que l’on peut griffonner, plier, déchirer parfois, et conserver précieusement aussi — un encadré, une photo, un titre, un fragment du jour.
Un bout d’histoire en guise de témoignage, fragile et tangible, qui rappellera à la postérité qu’il fut un temps où l’on touchait l’actualité du bout des doigts, et où, oui, on avait encore une sensibilité.
Ça y est !
Le papier n’a peut-être pas dit son dernier mot ?
Daniel Latif
Photos : DL /DR